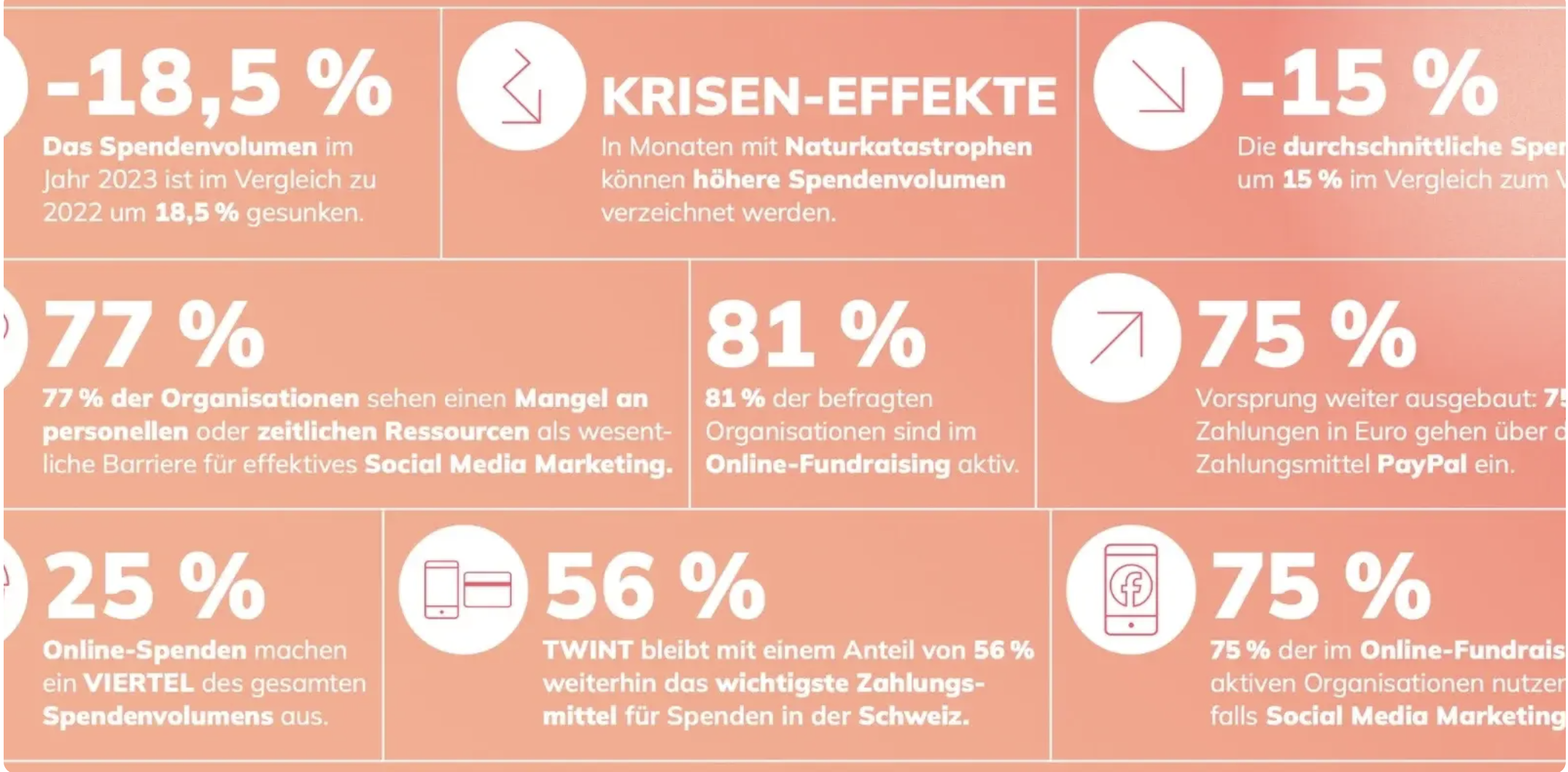La psychologie du don
Que se cache-t-il derrière le phénomène des « dons » et de quelle manière les gens s'impliquent-ils ? Vous trouverez ces informations et bien d'autres encore dans cet article.
Pour de nombreux psychologues, le fait que les gens veuillent aider et faire des dons est toujours un phénomène très intéressant. Ils se demandent notamment ce qui motive les gens à mettre leurs propres intérêts de côté pour un moment et à faire quelque chose pour d'autres personnes, souvent des inconnus, et à mettre leur argent durement gagné à la disposition d'une bonne cause Nous allons nous pencher sur cette question.
Pourquoi faire un don pour une bonne cause : les motivations du don
Pourquoi ouvrons-nous nos cœurs et nos portefeuilles pour aider les autres ? Les raisons pour lesquelles nous faisons des dons à de bonnes causes sont variées et profondes. En examinant les motivations du don, nous explorons les ressorts psychologiques, sociaux et émotionnels qui nous poussent à donner et à participer ainsi à quelque chose de plus grand
L'émotion et les motifs rationnels qui sous-tendent la donation
Les motifs de don peuvent être divisés en deux catégories : les motifs émotionnels et les motifs rationnels. C'est souvent une interaction complexe de motifs émotionnels et rationnels qui détermine si et pour quelle cause une personne fait un don. Un motif purement émotionnel consiste à faire un don par compassion. Dans le domaine de l'aide humanitaire, comme les catastrophes naturelles, la compassion est l'un des principaux moteurs. D'autres raisons purement émotionnelles sont la gratitude et la pure joie de donner et de faire un don. Les raisons rationnelles peuvent inclure des avantages fiscaux et des incitations matérielles telles que la possibilité de gagner des invitations à des événements ou à des concours.
Lorsque le don est motivé par un sentiment de responsabilité, c'est-à-dire par la nécessité d'apporter une contribution, par exemple à des projets de recherche ou environnementaux, ou par la reconnaissance, les composantes émotionnelles et rationnelles jouent toutes deux un rôle. Les facteurs sociodémographiques tels que le sexe, l'âge, le revenu, la religion, l'état civil, la situation professionnelle et l'éducation jouent également un rôle dans les dons. Certaines expériences ont montré, par exemple, que les femmes donnent plus souvent que les hommes et que la volonté de donner augmente avec l'âge.
Altruisme pur et altruisme impur
Il est également rare que nous agissions de manière purement altruiste, c'est-à-dire pour des raisons altruistes. Les motivations altruistes sont souvent mêlées à des motivations égoïstes. Les économistes distinguent deux types d'altruisme. D'une part, « l'altruisme pur », qui est axé sur les résultats. Les donateurs tirent leur satisfaction du fait que leur don peut aider les personnes concernées. Ils apprécient le travail de l'organisation et sont satisfaits des résultats des campagnes de collecte de fonds.
Dans « l'altruisme impur », les donateurs tirent une satisfaction de leur propre comportement. Ils tirent de la valeur du fait qu'ils contribuent eux-mêmes à la mission sociale de l'organisation et qu'ils agissent moralement selon leurs propres idées. Cependant, cette forme d'altruisme n'est pas indépendante du bien-être du bénéficiaire.
Paul Slovic, professeur de psychologie à l'université de l'Oregon, aux États-Unis, est l'un des principaux chercheurs dans le domaine de la motivation par le don. Il étudie la psychologie des dons depuis plus de dix ans.
« Nous aidons les autres parce que cela nous fait du bien, pas nécessairement parce qu'ils ont besoin d'aide. »
Paul Slovic Psychology Professor at the University of Oregon, USA
Une question s'impose désormais : Faisons-nous des dons uniquement pour soulager notre conscience ?
Monsieur Slovic s'est penché sur la question de savoir ce qui influence la volonté des gens de faire un don. Dans l'une de ses expériences, il a présenté aux sujets une photo montrant une jeune fille africaine affamée. Un groupe n'a vu que cette photo, avec le nom de la jeune fille et sa biographie, tandis qu'un autre groupe a vu des statistiques sur l'ampleur de la famine juste à côté : le nombre de personnes à mourir de faim, d'enfants à tomber malades ou à mourir de malnutrition. Ceux qui n'ont vu que la photo de l'enfant ont donné deux fois plus en moyenne. « Nous réagissons fortement aux personnes qui sont dans le besoin », déclare monsieur Slovic. « Elles ont un visage, un nom, une histoire. Les chiffres nous rebutent. Ils ne transmettent pas d'émotions. »
Lorsqu'une catastrophe se produit et qu'elle déclenche une réaction médiatique importante, des sommes considérables sont rapidement collectées, comme ce fut le cas lors des attaques terroristes contre le World Trade Center et le Pentagone le 11 septembre 2001. Pourquoi, en revanche, des organisations telles que Médecins sans frontières ont-elles du mal à collecter suffisamment de fonds pour lutter contre une terrible épidémie telle que celle d'Ebola ? L'une des raisons est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de télévision qui parcourent l'Afrique de l'Ouest pour interviewer des malades. En outre, les maladies telles qu'Ebola, le paludisme et le sida sont des problèmes diffus, sans localisation fixe, et donc sans point de référence unique et direct pour un don.
Selon monsieur Slovic, une catastrophe naturelle suit les règles d'une histoire : elle a un début, elle se développe dans la « partie principale » et, à un moment donné, une fin est prévisible. De nombreuses maladies graves, en revanche, se caractérisent par une fin ouverte et inconnue. En outre, il n'existe pas de médicament permettant de lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola, par exemple. « Un don est alors perçu comme une goutte d'eau dans l'océan. Il est impossible d'en observer les effets », explique monsieur Slovic. « L'arithmétique de la compassion est étrange. Et souvent irrationnelle. »
Les obstacles sur le chemin de la bonne cause : les obstacles aux dons
Malgré le désir de soutenir et de faire une différence positive, les donateurs se heurtent parfois à des obstacles qui les empêchent de faire un don. Ces obstacles au don peuvent être nombreux et variés, qu'il s'agisse de contraintes financières, de méfiance à l'égard des organisations ou simplement d'ignorance du besoin de soutien. Dans un bref aperçu, nous souhaitons mettre en évidence ces obstacles et montrer comment ils peuvent être surmontés.
Exigences excessives dues à l'ampleur
Dans le cadre d'une expérience menée aux États-Unis, des sujets ont été répartis en trois groupes et ont reçu des informations sur une organisation qui aide les enfants aux États-Unis et dans le monde entier. Le premier groupe n'a reçu que des informations générales : « Les pénuries alimentaires au Malawi touchent plus de trois millions d'enfants. » Le second groupe s'est vu montrer la photo d'une jeune Malawienne nommée Rokia et a appris que le don pourrait changer sa vie pour le mieux. Le résultat a été que le deuxième groupe a donné beaucoup plus que le groupe qui n'a reçu que des informations générales et statistiques. Un troisième groupe a reçu à la fois des informations générales et des informations sur Rokia. Ils ont donné plus que le groupe 1 mais moins que le groupe 2, confirmant une fois de plus que nous donnons beaucoup moins lorsque nous ne sommes confrontés qu'à des chiffres et des statistiques.
Lorsque l'objectif du don n'est pas à portée de main
Ce n'est pas un secret que nous nous soucions de nos proches. Il n'est donc pas surprenant que nous soyons d'autant plus touchés par les tragédies quand elles sont proches de nous.
Exemple:
Le peuple américain a donné 1,54 milliard de dollars pour la catastrophe du tsunami en 2004, ce qui représente moins d'un quart des 6,5 milliards de dollars donnés en Amérique aux victimes de l'ouragan Katrina. En dépit du fait que l'ouragan a tué 1 600 personnes et que le tsunami de 2004 a fait 220 000 victimes.
Ce fait était beaucoup plus facile à assimiler avant l'avènement de la communication numérique. Mais à l'heure où nous pouvons recevoir des images du monde entier en quelques secondes, c'est beaucoup plus difficile à comprendre.
Le sentiment d'inutilité du don
Comme indiqué plus haut, nous sommes rapidement dépassés par l'ampleur des besoins. Lorsque les chercheurs ont annoncé aux participants à une expérience que plusieurs milliers de personnes étaient en danger dans un camp de réfugiés au Rwanda et leur ont demandé de faire un don pour les réfugiés, leur volonté de faire un don était liée au nombre de personnes qu'ils pouvaient sauver en proportion. Ils étaient plus disposés à faire un don s'ils pouvaient aider 1 500 réfugiés sur 5 000 que s'ils pouvaient sauver le même nombre, mais cette fois sur un total de 10 000 réfugiés. Plus le pourcentage est faible, moins ils sont disposés à faire un don. Les psychologues appellent ce phénomène la « pensée inutile ». Paul Sloviv estime que ce phénomène est probablement lié à un sentiment de culpabilité à l'égard des personnes qui ne peuvent être sauvées. Ces sentiments de culpabilité ont donc probablement un effet négatif sur notre compassion et notre altruisme.
La dispersion des responsabilités
Ce phénomène est souvent appelé « effet du spectateur » et peut être facilement observé dans des situations quotidiennes. En bref, nous supposons qu'un nombre suffisant d'autres personnes sont au courant de quelque chose et que l'une d'entre elles fera ce qu'il faut faire, par exemple en faisant un don pour une bonne cause.
La pensée de l'argent
La simple pensée de l'argent peut également inhiber l'altruisme. Lors d'une expérience, les chercheurs ont entraîné un groupe de participants à penser à l'argent, par exemple en plaçant des piles d'argent à côté d'eux au Monopoly. Le groupe « contrôle » n'a pas reçu d'aide-mémoire monétaire. Le groupe « argent » s'est montré moins coopératif en mettant plus de temps à demander de l'aide pour une tâche difficile. Ces participants gardé une plus grande distance avec les autres, ont aidé beaucoup moins souvent et ont donné moins de l'argent qu'ils ont reçu pour participer à l'étude. Ce comportement pourrait être dû au fait que les gens pensent pouvoir acheter quelque chose. On suppose que ce sentiment limite la volonté de faire un don. L'égoïsme est encouragé et le sens de la communauté diminue considérablement.
Manque de transparence
De nombreux donateurs potentiels sont également inhibés par la crainte que leur don ne soit pas utilisé efficacement ou qu'il ne soit pas utilisé aux fins prévues. Les rapports sur le détournement des dons, qui ne cessent d'apparaître, alimentent encore cette crainte.
« L'organisation sert de point d'ancrage à la confiance, son nom doit être garant de la sécurité comme une marque. »
Frederyk Meyer Fundraiser Magazin
Que peuvent faire les collecteurs de fonds ?
J'aimerais vous présenter ici quelques options que vous pouvez utiliser pour réduire ou éviter les réactions défensives qui nous empêchent de faire un don.
- Images : utilisez des images fortes et concentrez-vous davantage sur les destins individuels
- Communauté : créez un sentiment de communauté et d'équité
- Soyez transparent : assurez la transparence des activités de l'organisation et de l'utilisation des dons
- Terrain d'entente : montrez le lien qui nous unit à des personnes situées à des milliers de kilomètres. Nous vivons dans un seul monde et nous sommes tous aussi importants les uns que les autres !
- Influencez : faites comprendre aux donateurs que leur don n'est pas une simple « goutte d'eau dans l'océan »
- Racontez des histoires : racontez des histoires personnelles percutantes
- Montrez des alternatives : montrez d'autres moyens d'aider que les dons financiers
- Les VIP : obtenez l'adhésion d'éminents sympathisants
Parlez de vos initiatives
Les raisons et les motivations qui poussent les gens à faire un don sont nombreuses et variées. Mais quelle que soit la raison, les dons sont importants et peuvent aider des personnes dans le monde entier. Certains obstacles aux dons peuvent être contrés par des mesures simples, d'autres sont plus complexes et difficiles à appréhender. Nombre d'entre eux résultent d'un réseau complexe de motivations émotionnelles et rationnelles dont nous n'avons souvent pas conscience nous-mêmes. Parler de charité peut contribuer à créer une culture du don. Montrez aux donateurs potentiels que leur don ne sera pas inutile et qu'ils peuvent faire la différence, à la fois dans leur communauté locale et dans le monde entier et qu'il peut contribuer à réduire l'anxiété. Des histoires fortes et personnelles nous aident à comprendre ce que nous ne sommes souvent plus en mesure de percevoir dans le flot de données. Forts de ces connaissances et de ces conseils, nous vous souhaitons de continuer à collecter des fonds avec succès !

%20(1)-1.png)